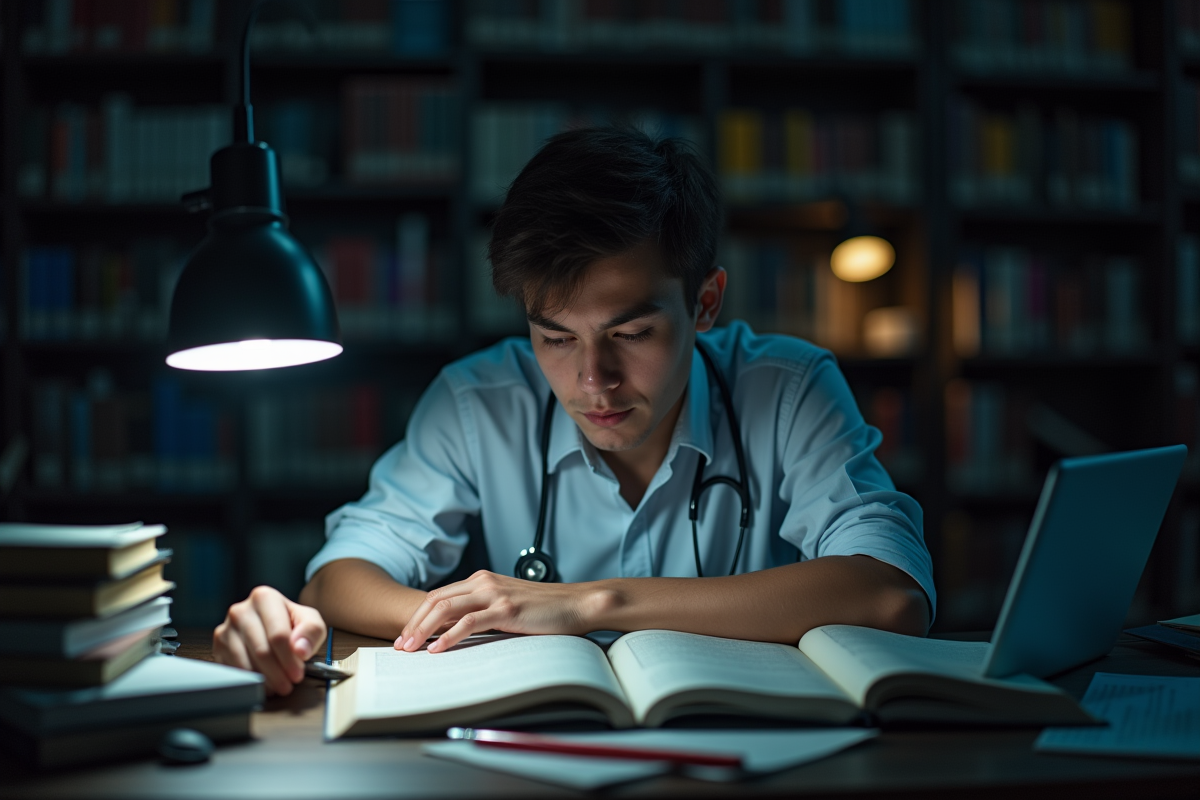Le passage de la première à la deuxième année de médecine affiche chaque année un taux d’échec élevé, malgré la réforme récente des voies d’accès. L’écart entre le nombre de places disponibles et le nombre de candidats admis reste considérable, même si de nouvelles filières comme la LAS ont été introduites pour diversifier les profils.
La durée totale des études varie fortement selon la spécialité choisie, oscillant de neuf à douze ans, avec des disparités marquées dans les exigences académiques et pratiques. Les critères d’admission évoluent régulièrement, contraignant les candidats à adapter leur stratégie d’orientation.
Comprendre les voies PASS et LAS : quelles différences pour accéder aux études de médecine ?
En France, deux portes se sont imposées pour accéder aux études médicales : le PASS (parcours accès santé spécifique) et la LAS (licence avec option accès santé). Le PASS, héritier direct de la PACES, reste la voie la plus empruntée. Les étudiants y plongent dans un bain de sciences biomédicales, tout en suivant une option disciplinaire extérieure à la santé. Cette option n’est pas là pour faire joli : elle permet de rebondir si la sélection en médecine échoue.
De son côté, la LAS cible ceux qui préfèrent une licence classique, droit, lettres, sciences, agrémentée d’une option santé. Cette alternative propose un rythme moins binaire, où la réussite ne dépend plus uniquement des notes en sciences, mais de l’ensemble du parcours universitaire.
Voici comment se distinguent ces deux voies :
- PASS : enseignement centré sur la santé, avec une option obligatoire, hors domaine médical
- LAS : licence universitaire classique, accompagnée d’une option santé facultative mais déterminante
Derrière ces schémas, la sélection reste redoutable. Les taux de réussite varient d’une université à l’autre, mais la tension académique est palpable, que l’on choisisse PASS ou LAS. Le choix du parcours, au fond, repose sur l’appétence disciplinaire et la capacité de chacun à encaisser une cadence exigeante dès la première année.
Études de médecine : combien d’années selon les parcours et les spécialités ?
Chaque année de médecine s’ajoute comme une marche sur laquelle l’étudiant mesure son souffle. Le schéma est connu : six ans pour devenir médecin généraliste, puis trois à cinq ans de D.E.S. (diplôme d’études spécialisées) selon la discipline choisie.
Le parcours commence par un premier cycle de trois ans où l’on jongle entre sciences fondamentales, physiopathologie, premiers pas à l’hôpital. Après la sélection du PASS ou de la LAS, la deuxième année marque un virage. Les cours et les travaux dirigés s’intensifient, la masse de connaissances à assimiler explose. Beaucoup la pointent comme l’une des étapes les plus ardues du cursus, en raison du volume à ingurgiter et de l’adaptation à une nouvelle méthode de travail.
Vient ensuite le deuxième cycle, trois années au cours desquelles l’étudiant devient externe et partage son temps entre salle de cours et service hospitalier. C’est là que tout bascule : gardes, dossiers médicaux, confrontation avec le réel. Au bout de ce tunnel, le concours national de l’internat tranche et oriente vers la spécialité désirée.
La spécialisation achève la formation : trois à cinq années selon la discipline, où l’interne assume progressivement ses responsabilités futures. Qu’il s’agisse de médecine générale, de chirurgie ou d’une autre voie, l’exigence s’intensifie.
Au final, la durée des études médicales s’étire entre neuf et onze années, sans compter les compléments de formation. Un marathon qui forge l’endurance, la discipline et la résilience indispensables à la pratique médicale.
Admission en médecine : démarches pratiques et critères de choix à connaître
Entrer en médecine ne se limite plus à un concours unique. Parcoursup s’est imposé comme le passage obligé. Chaque université fixe un quota de places via le système du nummus apertus. Le numérus clausus appartient à l’histoire, mais la compétition reste rude.
La procédure commence sur Parcoursup, où il faut sélectionner en priorité les universités proposant PASS ou LAS. L’attribution des places dépend des résultats scolaires, de la motivation affichée et du projet professionnel, mais aussi de la ville universitaire visée, un paramètre qui influence la concurrence et les conditions d’accompagnement.
Critères de sélection et stratégies
Plusieurs critères sont déterminants pour les commissions d’admission :
- Le parcours antérieur : notes obtenues, spécialités suivies au lycée
- L’alignement du projet d’études avec la formation visée
- La capacité du candidat à démontrer une motivation solide pour la santé
- Le choix de la ville universitaire, qui pèse sur la concurrence et le soutien proposé
Les étudiants en médecine doivent aussi se préparer à une charge de travail conséquente et à la confrontation avec la réalité hospitalière. Certains choisissent la prépa médecine pour gagner en méthode et en efficacité. La première année, qu’elle soit PASS ou LAS, agit comme un filtre impitoyable : peu d’élus, rythme effréné, pression constante. Les stratégies varient, mais une certitude domine : seule une organisation méthodique et une implication totale permettent d’affronter ce défi.
Spécialités médicales : classement par durée et popularité pour mieux planifier sa carrière
Le choix d’une spécialité médicale influence non seulement la durée des études, mais aussi le quotidien professionnel. Certaines disciplines imposent un long parcours et une sélection drastique, d’autres offrent un accès plus rapide à la pratique clinique.
Parmi les spécialités les plus convoitées, la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique attire chaque année une foule de candidats pour un nombre de places limité à l’internat. La chirurgie maxillo-faciale se distingue également par sa technicité et son prestige, ce qui explique son attractivité.
À l’inverse, la médecine physique et de réadaptation ou la psychiatrie peinent parfois à séduire, alors même que les besoins augmentent dans la population. Quant à la pharmacie, l’odontologie ou la maïeutique (formation des sages-femmes), elles proposent des parcours spécifiques, ouverts dès la première année ou via des passerelles, pour répondre à la diversité des vocations.
Voici un aperçu des principales spécialités, leur durée de formation et leur attractivité :
| Spécialité | Durée totale d’études (après le bac) | Popularité (choix à l’internat) |
|---|---|---|
| Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 11 à 12 ans | Très forte |
| Chirurgie maxillo-faciale | 11 à 12 ans | Forte |
| Médecine générale | 9 ans | Élevée |
| Médecine physique et de réadaptation | 10 ans | Modérée |
| Pédiatrie | 10 ans | Bonne |
Des disciplines comme l’oto-rhino-laryngologie (ORL) ou la chirurgie orthopédique et traumatologique regagnent du terrain, portées par l’innovation technique et l’évolution des besoins de santé publique. Avant d’affiner son projet, mieux vaut mesurer la longueur du parcours et plonger dans la réalité du métier visé.
Face à ces années d’intensité, une certitude : chaque étape façonne autant le médecin que la personne. Et ceux qui franchissent la dernière marche savent que la médecine ne s’apprend jamais tout à fait, même diplôme en poche.